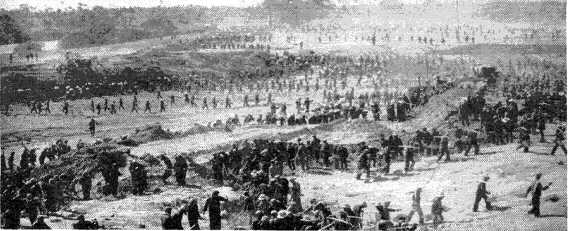|
1
000km à travers le Kampuchea démocratique (Cambodge) (5)
La question de
l'eau
La question de l'eau est une
question-clé au Kampuchea . Il n'est pas besoin
d'être un grand expert agricole pour le comprendre.
Comment la maîtriser ? Comment l'utiliser au mieux ?
Car elle est à la fois source de vie et
calamité naturelle. Oui, une calamité
naturelle quand l'inondation annuelle de la saison humide
dépasse les limites habituelles, quand elle recouvre
toutes les cultures, empêche la croissance des
plantes, calamité naturelle à l'inverse quand
elle fait défaut d'octobre à juin lors de la
saison sèche. Il faut se rendre maitre de la nature,
canaliser, emmagasiner l'eau quand elle abonde, la restituer
aux terres quand elle manque, et l'eau devient alors source
de vie car le soleil est toujours présent au
Kampuchea, la plus basse température de
l'année, c'est... 16 degrés !
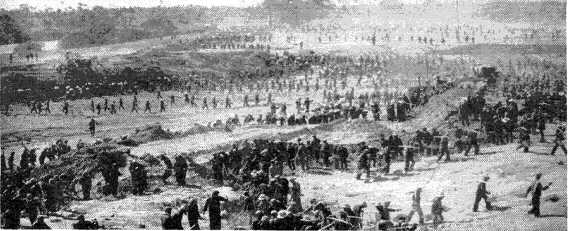
|
Construction d'un barrage dans le nord du
Kampuchea. Un travail gigantesque à
l'échelon du pays, mais beaucoup de bruit,
beaucoup de rires (Photo Kampuchea).
|
La maîtrise de l'eau,
c'est la clé du développement au Kampuchea.
Avec l'eau on a du riz, avec le riz la base d'une
agriculture indépendante et l'agriculture est la base
d'accumulation de richesses pour édifier
l'industrie.
Dans le
passé, au XIe et XIIe siècle, la
maîtrise de l'eau a été la base de la
puissance de la dynastie d'Angkor. Quand on visite Angkor,
il y a ses temples magnifiques, leurs sculptures pleines de
finesse ou d'humour, il y a aussi la base de l'une de ces "
sept merveilles du monde " : d'immenses réservoirs
d'eau, le " Baray occidental ", à partir desquels
avaient été mis en place il y a plus de huit
siècles, un système d'irrigation complexe et
techniquement fort avancé pour
l'époque.
Du temps de Lon Nol,
le Baray était devenu un lieu de plaisir et de
corruption international, on y venait par charters de Hong
Kong ou de Singapour pour y faire du yatching ou s'y dorer
sur les plages. Aujourd'hui, le Baray occidental a repris sa
fonction première ; à la Libération on
l'a recreusé en partie et on l'a
réaménagé en réservoir d'eau
pour l'irrigation de la région de Siem Reap. Nous
sommes allés près de l'un des barrages
construits récemment. Le silence est profond
près des rives du Baray. On y entend sauter les
grenouilles... mais de là s'écoule l'eau qui
donne la richesse à deux districts.
On a construit en
trois années bien d'autres barrages, bien d'autres
réservoirs. Une quinzaine au total contenant 2 800
millions de m3 d'eau qui permettent d'irriguer 400 000
hectares de terres en toutes saisons. C'est là
l'explication du grand changement survenu dans les campagnes
du Kampuchea, la verdeur des rizières, leur
agencement en carré entre les canaux d'irrigation
rectilignes, la boue bénéfique des
rizières ou on laboure et où on récolte
désormais en toute saison, tiennent à cet
effort sans précédent du peuple du Kampuchea
pour maîtriser l'eau.
Nous avons vu des
signes de cet effort partout. Certains camarades qui nous
accompagnaient ne reconnaissaient pas certains coins tant
ils avaient changé par le nouveau système
d'irrigation. Il faut faire des barrages, des
réservoirs, creuser des canaux, construire des petits
ponts car les canaux traversent sans cesse la route. On a
parlé de " résille de dentelle " pour
décrire ce système d'irrigation, cela est vrai
et demande autant de minutie, de courage et de
travail.
UNE MOBILISATION EXTRAORDINAIRE
Nous avons vu le barrage "
1er janvier " sur le fleuve Chinit, dans la région de
Kom-pong Thom, dont le film " Kampuchea démocratique
" montre la construction ; elle a duré cinq mois,
mobilisant en permanence 30 000 personnes nuit et jour. La
chute d'eau est rapide et permettra une utilisation
hydro-électrique plus tard. Pour l'heure, on
recueille les poissons qui sautent de la chute dans un filet
! La forêt a été ennoyée sur dix
kilomètres de profondeur derrière le canal, de
l'autre côté, il y a des rizières
impeccables. Avant 1977, il n'y avait pas ces centaines
d'hectares de cultures, aujourd'hui, on y expérimente
des croisements de semences de riz.
Du barrage 1er
janvier, nous prenons le bateau et pendant plusieurs
kilomètres, nous suivons un canal d'irrigation de
grande largeur. Sur la berge, il y a encore des travaux, une
scierie finie depuis deux semaines, des ponts qu'on termine,
des rizières qui scintillent. Partout, on travaille,
mais les uns et les autres, et surtout les jeunes, trouvent
le temps de nous saluer de la main, d'applaudir. Le
conducteur de bateau a 17 ans. Il en parait beaucoup moins,
jeune au visage sérieux et souriant à la fois,
à l'image du Kampuchea nouveau.
Bientôt,
à l'horizon, nous apercevons une foule de gens ; des
centaines de paillotes et de constructions provisoires se
pressent sur la berge. Nos accompagnateurs nous en ont fait
la surprise : nous arrivons près d'un grand chantier
de construction, celui du barrage " 6 janvier " sur une
rivière parallèle à la rivière
Chinit. Un chantier de construction semblable à celui
du film. Quatre mille jeunes y travaillent pour trois mois.
Le barrage est bien avancé déjà : on y
coule le ciment dans l'armature de fer, la digue de terre
prend forme peu à peu. Les jeunes ont de 15 à
22 ans : ils viennent de toute la province pour
réaliser cette " action concentrée ". comme on
dit ici. On les appelle les " brigades mobiles ", groupes de
jeunes toujours prêts à prêter main forte
au moment des récoltes ou pour les grands travaux.
Brigades mobiles ? C'est un terme bien adapté car
c'est bien une guerre que mènent ces jeunes et tout
le peuple contre l'exploitation, contre la pauvreté
pour le développement. Certains mauvais esprits
diront que cela signifie la discipline militaire. Eh bien,
ils se tromperont complètement. Ici, sur le chantier,
l'atmosphère est faite de travail et d'efforts : en
longues files régulières, les jeunes portent
qui de la terre, qui du ciment... Mais que de bruits, de
rires : c'est beaucoup moins solennel que les scènes
du film et aussi plus émouvant encore. Il faut
l'avouer, notre arrivée a quelque peu
désorganisé le travail, on nous entoure, on
parle un peu, on applaudit, les jeunes filles
éclatent de rire à entendre les tentatives du
camarade Jurquet à prononcer un ou deux mots en
khmer.
Ces jeunes savent
qui nous sommes et un vrai courant d'amitié, de
fraternité passe entre nous. Ici, on comprend bien
que le peuple mobilisé peut accomplir des miracles. "
Embrigadés " ces jeunes ? Que non ! Voilà des
prétendus " forçats du régime des
Khmers rouges " qui ont bien de la gaieté et de
l'enthousiasme ! Certains détracteurs du Kampuchea
d'aujourd'hui prétendraient encore que "
c'était un coup monté " : n'ont-ils pas dit
dans la presse américaine, après le retour de
nos camarades américains, que les temples d'Angkor
avaient été nettoyés pour leur visite
et qu'on les avait détruits après leur passage
!! On les aura reconstruits pour nous alors ! Où
conduit la hargne des réactionnaires ?
Camille GRANOT
(Demain :
une plantation d'hévéas)
|
Les
coopératives
La
coopérative c'est l'organisation de base de
la société socialiste au Kampuchea
dans les campagnes, En ville, le syndicat joue le
même rôle. L'un comme l'autre organise
le pouvoir révolutionnaire à
l'échelon le plus bas. De plus la
coopérative remplit des fonctions
économiques (agricole, artisanale,
industrielle et de transport) et sociales
(santé, hygiène, éducation,
culture, etc.)
Les
coopératives au Kampuchea regroupent de 300
à 1 000 familles, selon la situation
concrète ; elles sont plus nombreuses quand
les villages sont concentrés sur un petit
territoire.
Chaque coopérative applique la
politique définie par le Parti dans tous les
domaines, notamment dans les tâches de la
période : défense de
l'indépendance nationale, poursuite de la
révolution socialiste et édification
du socialisme. Ainsi, chaque coopérative
possède son unité de défense ;
celle-ci est plus importante dans les
coopératives frontalières.
La
coopérative est dirigée par un "
comité de direction " de trois à dix
membres qui se répartissent les tâches
: politiques, idéologiques, d'organisation,
de production, culturelles, etc. Elle fonctionne
sur la base du centralisme démocratique.
Exemple, pour l'application du plan quadriennal
(défini pour quatre ans) : on discute
à l'intérieur de la
coopérative pour savoir si l'on peut
accomplir le plan ou le dépasser. Peut-on
obtenir l'objectif de 3,5 tonnes par hectares de
riz si on fait une seule récolte et 7 tonnes
si l'on en fait deux ? On discute des points forts,
des points faibles de la coopérative ; on
confronte les avis de tous et on présente
l'avis de la coopérative à
l'échelon supérieur. De la même
façon on répartit les forces de
travail selon les possibilités de chacun, sa
force, son âge, son état de
santé, ses compétences
propres.
Pour ce qui
est de la répartition des fruits du travail,
elle est collective. Il n'y a pas de salaire. La
moyenne pour chacun est de 312 kilogrammes de riz
par an ; bien sûr cela est réparti :
sur les chantiers de construction de barrages, elle
est de 30 kilogramme par mois, pour les enfants de
15 kilogrammes. Les fruits, les légumes, les
produits de l'élevage, les poissons
complètent l'alimentation de base en riz ;
dans les coopératives on mange tous ensemble
dans la cantine du village ou sur les champs
à midi.
Les
vêtements indispensables pour chacun sont
fournis et peu à peu, on construit une
maison neuve par famille. Ainsi ce que le pays
possède pour la satisfaction des besoins
élémentaires, nourriture, logement,
habillement, est réparti au sein du peuple.
C'est la grande pauvreté et
l'économie de pénurie qui
conditionnent une telle politique. Quand, en 1973,
le Front uni et le PCK ont constitué les
coopératives dans les zones
libérées, c'était une
nécessité pour faire face à la
spéculation liée à la guerre ;
ainsi les villages libérés
produisaient le riz en quantité suffisante
et pourtant les paysans en manquaient car il
était acheté à des prix
exorbitants par des marchands le faisant passer
dans la zone de Lon Nol ; l'organisation en
coopératives a stoppé cela et
diminué considérablement le
rôle de la monnaie. Aujourd'hui encore, on
n'utilise pas la monnaie au Kampuchea.
Pour bien
comprendre la vie et l'organisation dans les
coopératives du Kampuchea, il faut
connaître les traditions anciennes de la
société rurale khmere. De tout temps,
pour se défendre des féodaux, des
propriétaires fonciers, pour organiser
collectivement l'utilisation de 1'eau pour
irriguer, il y a eu entraide, coopération
entre les familles pour les travaux des champs. Les
cinq dernières années de guerre, les
privations les bombardements, le départ et
la mort des siens, ont terriblement renforce ces
liens. On s'appelle " sœur ", " frère ", "
oncle ", " neveu " dans les villages. De fait, la
création des coopératives n'a pas
rencontré beaucoup de difficultés
dans l'esprit des paysans ! cela correspondait aux
nécessités de la guerre. Aujourd'hui,
la conscience et l'éducation viennent
renforcer ce qui a été
approuvé dans des conditions
particulières. L'accord avec le
système coopératif devient
raisonné.
Voilà ce que nous ont expliqué les
camarades du Kampuchea concernant
l'édification des coopératives
:
" Les
problèmes qui peuvent surgir sont
résolus par l'explication par
l'éducation politique et idéologique,
pour que chacun comprenne la situation. On
s'efforce de travailler pour augmenter la
production, le niveau de vie. Comme on a le
pouvoir, on peut le faire ; chacun se sent les
maîtres de l'avenir ".
C.G.
|
|